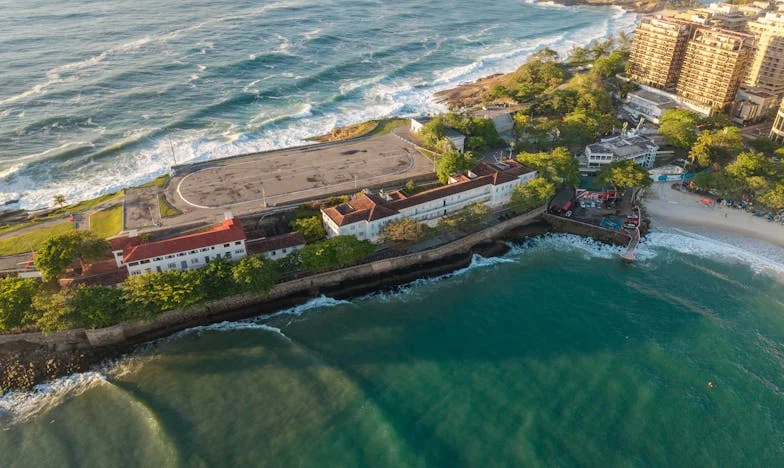Je ne suis pas votre bonne : L’histoire de Claire de Lyon
— Claire, tu pourrais au moins débarrasser la table !
La voix de ma belle-mère résonne dans la cuisine, tranchante comme un couteau. Je serre les dents, les mains tremblantes autour de l’assiette que je viens de finir de laver. Il est vingt-deux heures, un samedi soir comme tant d’autres dans cette maison lyonnaise où je me sens étrangère, même après toutes ces années.
Julien, mon mari, est assis au salon avec son père, un verre de vin à la main. Ils rient fort, discutent du dernier match de l’OL, comme si tout allait bien. Je jette un coup d’œil à mon reflet dans la vitre : cernes sous les yeux, cheveux attachés à la va-vite, sourire éteint. Où est passée la Claire qui rêvait d’ouvrir sa librairie ?
— Claire, tu as entendu ?
Je sursaute. Ma belle-mère me fixe, impatiente. Je hoche la tête et m’exécute. Depuis neuf ans, c’est toujours moi qui débarrasse, qui cuisine, qui gère les courses et les lessives. Même quand je travaillais encore à la médiathèque municipale, c’était pareil. Mais depuis que j’ai perdu mon poste lors du dernier plan social, tout le monde considère que je n’ai plus rien d’autre à faire que de servir.
Un soir, alors que je plie le linge dans notre chambre, Julien entre sans frapper.
— Tu pourrais faire un effort avec maman. Elle trouve que tu n’es pas très chaleureuse ces temps-ci.
Je sens une boule monter dans ma gorge.
— Et moi ? Tu t’es demandé comment je vais ?
Il soupire, lève les yeux au ciel.
— Tu dramatises toujours tout…
Je ravale mes larmes. Je ne veux pas pleurer devant lui. Pas encore.
Les jours passent, tous semblables. Je me lève tôt pour préparer le petit-déjeuner de tout le monde. Je fais les courses pour ma belle-mère qui ne conduit plus. Je m’occupe de son jardin alors que je déteste avoir les mains dans la terre. Le soir, je prépare des plats qu’elle critique toujours : « Ce n’est pas comme ça que ma mère faisait le gratin… »
Parfois, je m’enferme dans la salle de bains pour respirer un peu. Je pense à mon père qui me disait : « Ne laisse jamais personne décider à ta place. » Il est mort il y a cinq ans et depuis, je me sens seule face à cette famille qui n’est pas la mienne.
Un dimanche matin, alors que je range la vaisselle du petit-déjeuner, ma belle-sœur Élodie débarque avec ses deux enfants. Elle pose ses sacs sur la table et me lance :
— Tu peux surveiller les petits ? J’ai des courses à faire.
Je regarde Julien qui hausse les épaules :
— Allez, Claire, rends-toi utile.
Je serre les poings. Les enfants courent partout, renversent du jus d’orange sur le tapis. Je nettoie en silence pendant qu’Élodie s’en va sans un mot de remerciement.
Le soir venu, alors que tout le monde est devant la télévision, je m’assois seule sur le balcon. La ville s’étend devant moi, indifférente à ma détresse. J’ouvre mon carnet et relis les notes prises il y a des années pour mon projet de librairie : « Créer un lieu où chacun se sent chez soi… »
Je ferme les yeux et imagine une autre vie. Une vie où je ne suis pas réduite à une domestique invisible. Où mes envies comptent autant que celles des autres.
Le lendemain matin, j’ose enfin parler à Julien.
— J’en ai assez. Je ne suis pas ta bonne ni celle de ta famille. J’ai besoin de retrouver qui je suis.
Il me regarde comme si j’étais folle.
— Tu exagères… On a tous des obligations.
— Mais moi, je n’existe plus !
Il hausse le ton :
— Si tu n’es pas contente, tu n’as qu’à partir !
Un silence glacial s’installe. Mon cœur bat la chamade. Est-ce vraiment ce qu’il pense ? Que je ne suis qu’une pièce remplaçable dans ce puzzle familial ?
Je passe la nuit à réfléchir. À peser le pour et le contre. À me demander si j’ai encore la force de me battre pour moi-même.
Le lendemain matin, je fais mes valises en silence. Ma belle-mère me regarde sans comprendre.
— Où vas-tu ?
— Chez moi.
Elle rit jaune :
— Tu n’as pas de chez toi.
Je souris tristement.
— Pas encore… mais ça viendra.
Je claque la porte derrière moi et descends les escaliers quatre à quatre. Dans la rue, l’air frais me fouette le visage. Pour la première fois depuis des années, je me sens légère.
Je prends un café place Bellecour et j’appelle mon amie Sophie.
— J’ai besoin d’un endroit où dormir quelques jours…
Sa voix chaleureuse me rassure :
— Viens chez moi autant que tu veux ! On va réfléchir ensemble à ta librairie.
Je souris à travers mes larmes. Peut-être que tout n’est pas perdu.
Ce soir-là, allongée sur le canapé de Sophie, je repense à tout ce que j’ai enduré pour une famille qui ne m’a jamais acceptée comme je suis. Et si c’était enfin le début de ma vraie vie ?
Est-ce qu’on a le droit de dire stop quand on se sent effacée ? Combien d’entre nous vivent ainsi dans l’ombre des autres sans jamais oser s’affirmer ?