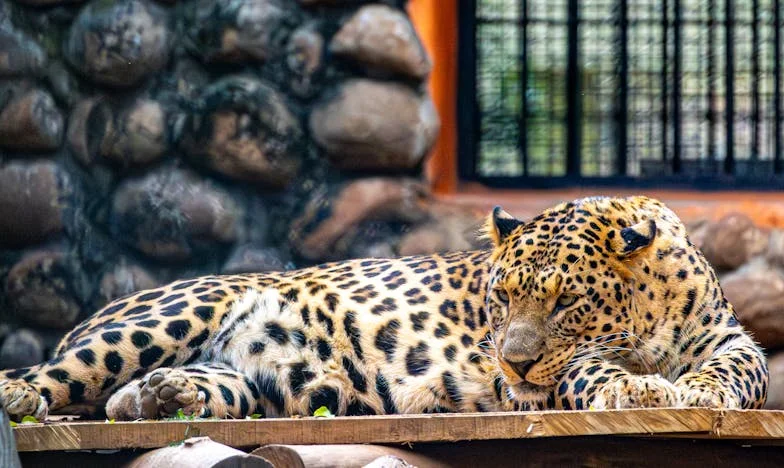« Il ne veut pas se sentir comme un clochard » : Quand notre fille nous a confrontés sur le droit au logement de son petit ami
« Mais maman, tu ne comprends pas ! Il ne veut pas se sentir comme un clochard, il mérite les mêmes droits que moi ! »
La voix de Camille résonne encore dans la cuisine, tranchante comme une lame. Je serre la tasse de café entre mes mains tremblantes. Jean, mon mari, lève les yeux au ciel, exaspéré. Il n’a jamais aimé Thomas, le petit ami de notre fille. Trop discret, trop pauvre, pas assez « stable » à son goût. Mais ce soir-là, c’est bien plus qu’une histoire d’amour adolescente qui explose dans notre salon : c’est une question de dignité humaine.
Camille vient d’avoir dix-neuf ans. Elle a décroché son bac avec mention et s’est envolée pour la fac à Lyon. Nous étions si fiers d’elle. Mais depuis quelques mois, elle revient souvent à la maison avec ce regard inquiet, cette tension dans la mâchoire. Ce soir, elle a craqué.
« Tu sais très bien que ses parents l’ont mis dehors ! »
Je baisse les yeux. Oui, je le sais. Thomas vient d’une famille déchirée par les dettes et les non-dits. Sa mère a refait sa vie à Marseille, son père s’est volatilisé après une énième dispute. Depuis deux semaines, Thomas dort sur le canapé d’un copain ou dans des squats insalubres. Camille l’a recueilli quelques nuits dans sa chambre universitaire, mais la directrice de la résidence l’a menacée d’exclusion.
Jean tape du poing sur la table :
« Ce n’est pas notre problème ! On ne va pas héberger tous les paumés de Lyon sous prétexte qu’ils sortent avec notre fille ! »
Camille éclate en sanglots. Je sens mon cœur se fissurer. Je repense à ma propre jeunesse à Grenoble, à mes galères d’étudiante, aux soirs où je sautais des repas pour payer mon loyer. Mais j’ai eu la chance d’avoir des parents présents. Thomas n’a rien.
« Tu te rends compte de ce que tu dis ? » hurle Camille à son père. « Tu parles de lui comme s’il était une maladie ! »
Le silence s’abat. Je voudrais prendre ma fille dans mes bras, lui dire que tout ira bien. Mais je suis paralysée par la peur : peur du regard des voisins, peur que Thomas profite de notre générosité, peur que Camille souffre.
La nuit tombe sur notre pavillon de banlieue lyonnaise. Jean allume une cigarette sur le balcon. Camille s’enferme dans sa chambre. Je reste seule dans la cuisine, assaillie par les souvenirs et les regrets.
Le lendemain matin, Camille descend les yeux gonflés.
« Je vais partir vivre avec lui », lâche-t-elle d’une voix blanche.
Jean explose :
« Tu n’as pas idée de ce que tu fais ! Tu vas gâcher ta vie pour un garçon qui n’a même pas un toit ! »
Camille le fixe droit dans les yeux :
« Justement. Parce qu’il n’a pas de toit, il a besoin qu’on l’aide. Tu crois que c’est facile pour lui ? Il ne veut pas être un fardeau. Il veut juste avoir les mêmes chances que moi. »
Je sens la colère monter en moi contre Jean, contre moi-même aussi. Depuis quand avons-nous oublié ce que c’est que d’avoir peur du lendemain ? Depuis quand jugeons-nous les autres à l’aune de leur compte en banque ?
Les jours passent et la tension ne retombe pas. Camille fait ses valises en silence. Thomas vient la chercher un soir pluvieux, trempé jusqu’aux os. Il me regarde avec des yeux fatigués mais fiers.
« Merci de m’avoir laissée rester ici quelques nuits », murmure-t-il.
Je voudrais lui dire que je suis désolée, que je comprends sa détresse. Mais les mots restent coincés dans ma gorge.
Après leur départ, la maison semble vide. Jean fait semblant de ne pas s’en soucier mais je le surprends parfois à regarder la photo de Camille sur le buffet.
Une semaine plus tard, Camille m’appelle en pleurs : ils ont été expulsés d’un squat par la police municipale. Elle dort chez une amie mais Thomas n’a nulle part où aller.
Je prends ma voiture sans réfléchir et file à Lyon. Je retrouve Camille blottie sur un banc du parc de la Tête d’Or, tremblante.
« Maman… je t’en supplie… aide-nous… »
Je craque enfin. J’appelle Jean :
« On va héberger Thomas quelques temps. Je ne peux pas laisser un gamin dormir dehors alors qu’on a une chambre vide. »
Il grogne mais ne proteste pas vraiment.
Thomas arrive chez nous le lendemain matin. Il est gêné, maladroit, mais il remercie mille fois. Peu à peu, il reprend confiance : il trouve un petit boulot dans une boulangerie du quartier, aide Camille dans ses révisions.
Les voisins jasent : « La fille des Martin héberge un SDF maintenant ? »
Mais je m’en fiche. Je vois ma fille sourire à nouveau.
Un soir, alors que nous dînons tous ensemble pour la première fois depuis des mois, Jean pose sa main sur l’épaule de Thomas :
« Tu sais… tout le monde peut traverser une mauvaise passe. L’important c’est de ne pas baisser les bras. »
Thomas hoche la tête, ému aux larmes.
Aujourd’hui encore, je me demande : pourquoi avons-nous tant hésité à tendre la main ? Qu’est-ce qui nous fait si peur dans la précarité des autres ? Et vous… auriez-vous ouvert votre porte ?